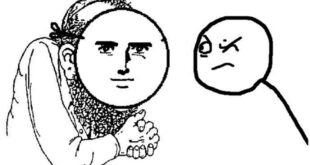Rémi Gration
Divergences Diurnes
07 novembre 2021
Enfin sorti de prison pour crime de jeu de mots, je viens d’emménager, d’urgence, dans une ville du Sud de la France — en somme, j’ai quitté une prison pour en rejoindre une autre. Récit.
La ville toute entière est un quartier de cité, version Venezuela, avec seulement de temps en temps une vue sur les bâtiments médiévaux qui surplombent la lie populassière. Barbiers bougnoules, salons de coiffure d’Abidjan pour négresses en manque de tresses, Donër Kebabs avec musique turque incluse dans le menu, et Tacos hallal sauce algérienne… tout ça, en bas de chez moi. Odeurs d’épices indiennes, aussi, parce qu’après tout : [insérez nom de ville du Sud de la France], c’est la diversité.
Le brouhaha musical de l’artisan Camerounais n’a d’égal que celui du tabac-presse tenu par le Congolais. Mais cela énerve les bougnoules autochtones, propriétaires des lieux depuis probablement des siècles, qui mettent leurs Raï’N’B encore plus forts car se sentant grand-remplacés. Rien ne va plus.

Que des non-blancs. Une seule personne de blanche dans mes environs : Brigitte, ma voisine d’en face, une boomeuse quadri-vaxxed en fin de vie qui, visiblement, au vu de ses livraisons de courses, semble ne pas vouloir sortir de chez elle. Il y a des parasites plus dangereux que d’autres, bien que moins à la mode. Mes voisins d’à-côté sont une famille entière de boucaques d’au moins 5 enfants. Sept paires de babouches sur le parvis de l’étage, amoncées devant la porte. Tout l’immeuble, toute la rue et tout le quartier sont bougnoules.
Quant à l’immeuble justement, difficile de faire plus vétuste… la cabine d’ascenseur, toute de papier-peint jetée, fait 50 cm sur 50 cm de technologie de sortie de guerre, et ça grince. Les marches de l’escalier sont cassées, ils y ont mis du lino… arraché. De ma fenêtre, le vis-à-vis avec le balcon d’une famille rom hébergée là gracieusement, m’offre la vue de poussettes se mêlant aux détritus. Tout est normal. Mais il faut redoubler de vigilance quand on se penche pour observer le monde extérieur : les bougnoules du dessus laissent régulièrement couler leurs eaux usées depuis leur balcon. Le Gange, comme tombé du ciel !

Les favelas, on y est. Un bidonville géant, avec murs en durs et permis de construire. C’est indescriptible.
Je suis allé en safari cet après-midi, histoire de me dégourdir les jambes et de me repérer un peu : je suis en fait le seul putain de blanc dans toute la ville. Je le savais ! Mais je voulais m’en assurer… ça fait toujours un petit quelque chose. Les jeunes, les vieux… le centre, les quartiers… les bruits, les odeurs, la vue… les clients, les commerçants… tout est bougnoule — ou quelque chose s’y approchant. Dans certaines rues, le Français y est très peu parlé. J’ai même ouïe dire que certaines impasses n’y ont jamais vu s’engouffrer un blanc, un vrai.
Ce qui se fait de plus clair, ici, serait quelque chose de métissé entre le gnoule et le gitan, un machin semblable à un narbonnoïde aux traits tunisiens. Et de temps en temps, au gré d’un hasard improbable, dans cet océan noir de merde biologique, une tâche rose en croise une autre. On en est choqués, et puis on oublie. Car il faut rester sur ses gardes. Après tout, on a quand même le droit de se perdre… même chez soi. Mais on n’en sort jamais vraiment indemne.
Les bougnoules, eux, toujours en groupe, jamais moins de 5 ou 6, aux angles des rues ou aux rebords des cafés. Dans une rue qui fait l’angle avec la mienne, j’ai même vu une dizaine de bougnoules rassemblés là, encagoulés et vêtus de noir… c’était 13 heures pétantes. Toujours trop de monde pour daigner être tranquille, mais jamais assez pour espérer quelque témoin pour le drame qui approche.

Putain, et les roms, qu’est-ce qu’il y a comme roms !, des roms avec des dreadlocks blonds tressés, smartphone à la main, haut de survet’ Adidas mais toujours robe à 5 millions de couleurs en mosaïque dégueulasse. Jamais vu ça.
Le souk, mais la version la plus amateure, l’expression la plus naturelle qui soit : des machines-à-laver qui s’offrent en spectacle au feu rouge, des meubles tout entièrement explosés laissés pour morts sur le bas-côté, et des matelas éreintés qui s’allouent des places de parkings. C’est dégueu, immonde… les sacs poubelle se décomposent à-même les trottoirs, que ces sous-races évitent instinctivement, comme une deuxième nature… parterre ça colle, partout ça pue. Des déchets partout. Absolument partout. Et même lorsqu’ils n’y sont pas, ils y sont quand même : on devine leurs emplacements, improvisés, par la trace indélébile qu’ils laissent là où ils sont habituellement abandonnés. Le bitume qui s’écaille, les murs qui tombent en lambeaux. Rien qui ne s’effrite pas. Tout est noirci, amoindri. Rien n’est viable. C’est Naples, version Wish. Lunel version Lidl.

Bien que surpeuplée, cette ville est orpheline, laissée à l’abandon, à la décomposition. Toutes sortes de vêtements exotiques, délavés, fripés et arrachés, suspendus à des similis de cordes-à-linges, faites en cordelettes probablement récupérées le long d’un regard d’eau de pluie… jonchant les murs à hauteur de poteaux électriques : le linge sale étalé sur les chemins aériens les plus possiblement mitoyens, s’entrelaçant de balcons en balcons comme le signe d’une unicité dans la merde familière la plus partagée. Tout est aménagé pour ressembler à la Narbonnoïdie parfaite. Le tableau est des plus complets.
Bref, une gigantesque fosse à merde avec des habitants à l’intérieur. Un mélange entre Sao Paulo, Cuba, Alger, Caracas et Abidjan — la carte postale en moins.
À la vue de toute cette ignoble hyperstructure de merde entassée, acceptée, codifiée, nomenclaturée ; un seul sentiment, très profond, très cruel envahit tout être sain : il faut purger tout cela. Dératiser. Tout brûler. Seul salut : vitrifier sans complexe et sans remords. Ne rien laisser de plus que le sol, et même le retourner, et le brûler encore. Le calciner. Jusqu’aux racines, à en faire fondre les entrailles. Plutôt un désert pendant mille ans que de risquer la repousse de ce cauchemar. Le moindre atome, la plus petite des molécules… le souvenir du souvenir de cet enfer doit être évacué à tout jamais. Et ne réveiller la bête, même oser ne prononcer son nom, sous aucun prétexte. Et laisser reposer. Longtemps. Ne rien recommencer avant d’en avoir perdu ne serait-ce que le soupçon de l’idée.
Post Scriptum : pour ce qui est de mon « appartement », l’ancien propriétaire est visiblement parti avec les meubles… mais, bon joueur, il m’a tout de même laissé une marmitte spéciale « Couscous Tunisien ». Il a pensé à tout. Je suis vraiment gâté.
 Démocratie Participative 卐 Le site le plus censuré d'Europe 卐
Démocratie Participative 卐 Le site le plus censuré d'Europe 卐